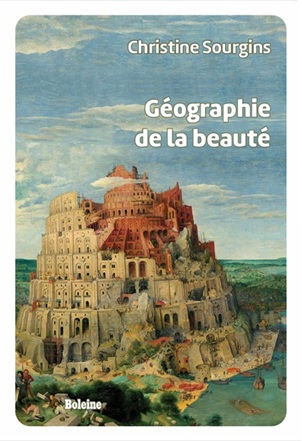Géographie de la beauté vient de paraître chez Boleine. Au même moment, le Catalogue raisonné de l’inachevé de Sophie Calle paraît chez Actes sud, l’artiste y recense jusqu’à ses échecs : aujourd’hui, tout peut relever de l’art, même « le raté ». Plutôt que des expériences esthétiques (avec un t) donc aptes à la perception du beau, il s’agit d’expériences esthésiques (avec un s), relevant de la simple perception, arrimées ensuite à des concepts. Une partie du monde culturel est passée à autre chose que le beau.
Chez l’homme de la rue, ce qui reste du beau est souvent une vision manichéenne voire morale: beau/laid redouble l’opposition bien/mal, pourtant régulièrement démentie par l’expérience. La raie gluante peinte par Chardin est dégoûtante mais son tableau ne l’est pas ; « Judith et Holopherne » du Caravage exhibe du sanguinolent mais l’œuvre n’est pas atroce. Pire, le beau est souvent confondu avec deux concurrents : le joli, conçu comme un beau amoindri, charmant et décoratif, et le sublime réputé plus que beau, son dépassement. L’esthétique se réduit alors à une courte échelle : laid, kitsch, joli, beau, et le sublime dominant cette hiérarchie.
Géographie de la beauté propose de sortir du manichéisme, de revenir à Delacroix : « il n’y a pas de degrés dans le beau ; la manière seule d’exciter le sentiment du beau diffère »(1). Bref, déployer non plus une échelle, mais une géographie du beau, ce dernier étant plus étendu et subtil qu’on ne croit. Il en est de même des registres littéraires : peu importe qu’un texte soit épique, lyrique, dramatique, comique, poétique ou didactique, etc. du moment qu’il est réussi ! Ainsi, dans les arts plastiques, certaines œuvres « plus curieuses que belles » relèvent du seul registre de l’intéressant. Mais, bien sûr, rien n’interdit à une œuvre intéressante de parvenir à la beauté… Car le beau peut jaillir (ou pas) de n’importe quel registre comme le feu de tout combustible, avec plus ou moins de facilité tout de même.
La Géographie de la beauté se joue sur 10 terroirs principaux : l’harmonieux, le sublime, le joli, le kitsch, l’étrange, l’intéressant, le primordial, le pulsionnel, le laid, le quelconque. Chaque territoire éveille des sentiments : la sérénité pour l’harmonieux, le bonheur pour le joli…etc. Les affects suscités par l’étrange vont de l’émerveillement à la peur car l’étrange affronte une altérité : les registres ont aussi leur point de visée…
Le beau n’est pas l’apanage d’un seul terroir esthétique, il prend appui, la plupart du temps mais pas obligatoirement, sur l’agencement de plusieurs. Dans cette « géo-poétique » du beau, les frontières sont parfois poreuses …
Le livre fait revivre, au fil de nombreux exemples, les enjeux de cette Géographie. Ainsi le kitsch, sous ses airs « rigolo », « cool », est un registre fort politique, d’où ses démêlés avec l’idéologie nazie, communiste ou… woke. De nos jours, le pulsionnel et l’intéressant s’avèrent hégémoniques ; dans l’AC, le laid s’unit à l’intéressant pour se légitimer…cette légitimation valant, pour lui, dispense de beauté. Or il y a bien une laideur obtuse (qu’un chapitre précisera) qui refuse de participer au beau…
Puisse ce livre être une boussole pour redéployer l’éventail des possibles du beau… Bon voyage !
Christine Sourgins
- Delacroix « Questions sur le beau ».